Le foie est un organe essentiel à la vie. Mais parfois il est fatigué et ne remplit plus correctement ses fonctions. Quels sont les meilleurs aliments pour préserver la santé de son foie ? Nous vous en détaillons 10.


Le Pr Walter Willett (Harvard) est considéré comme le plus éminent nutritionniste au monde. Dans cet entretien, il revient sur sa carrière et sur le pouvoir de l'alimentation pour prévenir les maladies.
Walter Willett est professeur émérite d’épidémiologie et de nutrition à l’École de santé publique de Harvard (Boston, Massachusetts). Né en 1945 dans une famille du Middle-West américain ayant des liens forts avec l’agriculture, il a obtenu son diplôme de médecin à l’université du Michigan avant de rejoindre Harvard dans les années 1970 pour continuer sa formation médicale. Il y a découvert le potentiel de l’épidémiologie à révéler les racines profondes des maux de ses patients, et aider ainsi à les prévenir.
Sous son impulsion, l’étude dite "des Infirmières" (Nurses' Health Study), ainsi nommée parce qu'elle porte sur des professionnelles de santé est devenue une formidable étude prospective portant sur l’alimentation, le mode de vie et la santé, la première à avoir ouvert nos yeux sur l’importance du lien entre nutrition et santé. Walter Willett a continué cette étude, de suivis en suivis, jusqu’en 2010. Ses recommandations pour un mode de vie sain nous sont maintenant familières : ne pas fumer, faire de l’exercice régulièrement, éviter les sucres ajoutés, les acides gras trans, les aliments industriels, l'excès de produits laitiers.
Pr Walter Willett : J’ai commencé par étudier la physique. Un membre de ma famille proche, physicien, m’y a intéressé. La physique est une matière formidable car elle est exacte et précise. Un des aspects centraux de la physique est la mesure et l’étude des erreurs de mesure, un domaine que je continue à trouver très utile aujourd’hui. Mais je me suis rendu compte que les physiciens travaillaient souvent dans les sous-sols des bâtiments, sur des sujets obscurs plutôt déconnectés du reste du monde. J’étais plus intéressé par le fait de voir le monde, c’est pourquoi j’ai étudié la science de l’alimentation. Georg Borgstrom, un de mes professeurs, m’a beaucoup inspiré. Son champ de recherche concernait la durabilité de l’approvisionnement alimentaire à l'échelle mondiale et il m’a intéressé aux problèmes globaux de la production alimentaire. J’ai aussi payé mes frais de scolarité à la faculté en cultivant des légumes ce qui m’a amené à m’intéresser aux aliments et à leur production.
Dans les années 1960, on pensait que le problème principal était la sous-alimentation. Avec raison, du moins sur une base globale. À cette époque, il existait aussi un intérêt assez général sur l'alimentation comme facteur contribuant au risque cardiovasculaire. J'ai saisi toutes les opportunités de travailler sur des projets liés à la nutrition lors de mes vacances universitaires. Je me suis moi-même prêté à un essai clinique. En effet, je vivais en colocation avec d'autres étudiants en médecine et nous prenions tous part à tour de rôle à une recherche clinique autour de l'alimentation.
Il s'agissait d’une expérience assez banale visant à établir des liens de cause à effet entre les quantités de vitamine C ingérées et les taux sanguins de vitamine C. Nous avons ainsi dû par exemple manger une alimentation très restrictive pendant dans plusieurs semaines.
Mais une de mes expériences les plus formatrices a consisté à diriger une petite enquête dans une petite communauté indienne du Michigan, la tribu Potawatomi. Avec un autre étudiant, nous avons passé un été à collecter des données, à faire des analyses sanguines et des mesures anthropométriques. Nous avions utilisé la méthode décrite par Martha Trulson et Bertha Burke du département de nutrition de l'école de santé publique de Harvard sur la collecte de données à l'aide de questionnaires sur la fréquence de consommation des aliments. Cette méthode s'est avérée très efficace pour recueillir un grand nombre d'informations sur ce que les gens de cette tribu mangeaient. Je me suis rendu compte à cette occasion que l'on pouvait collecter des données nutritionnelles très facilement. Ce que nous avons appris par ces questionnaires était très intéressant mais le résultat le plus choquant a été que 50% des adultes présentaient un diabète. Il s'est avéré par la suite que ce chiffre se retrouvait dans toutes les communautés amérindiennes à travers les Etats-Unis. Cela a soulevé la question évidente : « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la moitié des adultes souffre de diabète ? ».
Non, ce n'était pas clair. Je pense que nous comprenons mieux aujourd'hui ce phénomène. Il est clairement lié à une susceptibilité génétique qui ne se manifeste pas tant que vous n'avez pas un mode de vie et une alimentation de mauvaise qualité. Mais il est également très clair aujourd'hui que l'alimentation de ces personnes était un vrai carburant pour le diabète. Ces aliments qui provenaient pour la majorité du programme d'aide alimentaire du ministère de l'Agriculture se sont avérés responsables des forts taux de diabète constatés.
Cela a donc été une expérience très instructive. Quand je suis venu faire mon internat dans à l'hôpital de Boston au sein de l'école de médecine de Harvard, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs formidables très intéressés par la nutrition comme Frank Speizer avec qui je travaille toujours, Ron Arky ou Charlie Davidson, Je suis donc resté connecté à ce domaine même si je n'avais pas l'occasion de faire de recherche dessus à cette époque. J'ai aussi réalisé un stage en Tanzanie pendant ma formation médicale. Je l'ai tellement apprécié que je suis retourné plus tard là-bas enseigner 3 ans à l'université de Dar es Salaam.
C'était génial. J'y ai commencé à enseigner la médecine interne, ce qui me plaisait. Ici, la médecine interne sert surtout à aider les gens à maintenir leurs fonctions vitales, à empêcher qu'une maladie empire. Mais en Tanzanie les gens avaient des maladies que l'on pouvait guérir. Ils pouvaient rentrer chez eux après quelques jours de traitement, ce qui est gratifiant pour un médecin.
J’ai aussi aimé avoir des défis stimulants sous la forme de problèmes de santé publique qui m’ont permis d’apprécier combien l’épidémiologie est un outil puissant. C’est pour cela qu’à mon retour j’ai fait une thèse en épidémiologie qui m’a ouvert une perspective non enseignée en école de médecine. Quand quelqu’un souffre d’un cancer du sein ou d’une cataracte, personne ne se demande quelles en sont les causes. Pourquoi ? Dès que vous commencez à vous poser ce genre de questions, un grand nombre d’hypothèses émergent. Et il se trouve que la majorité d’entre elles ont un lien avec l’alimentation. À cette époque, peu de gens étudiaient les liens entre nutrition et maladies. L’alimentation était perçue comme importante de manière générale mais ce domaine semblait trop compliqué à étudier de manière plus précise.
Oui je l’ai commencée en rentrant, à la fin des années 1970. J’avais rencontré le principal investigateur, Frank Speizer lorsque je travaillais à l’hôpital de Boston. Les tout premiers temps avec un autre chercheur, nous conduisions l’Étude des infirmières sur une base quotidienne. J’ai ainsi fait ma thèse d’épidémiologie sur le lien entre cigarette et maladie cardiovasculaire en utilisant les données de l’Étude des infirmières. J’ai réalisé que cet hôpital représentait le lieu idéal pour étudier les liens entre alimentation et la survenue à terme des problèmes de santé, y compris les maladies cardiovasculaires et le cancer.
Dans le département nutrition, on donnait alors des recommandations alimentaires assez strictes aux patients comme par exemple d’éviter les œufs à cause de leur teneur élevée en cholestérol – à cette époque un taux de cholestérol élevé était considéré comme l’un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Étant donné la force des recommandations données, on aurait pu penser qu’il existait des douzaines d’études montrant que les personnes qui mangeaient beaucoup d’œufs présentaient un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Mais en réalité il y avait zéro étude sur ce sujet. C’était une hypothèse, une intuition, mais il n’existait aucune preuve directe. Et cette recommandation a été suffisamment répétée et martelée pour finir par être gravée dans le marbre. Il y avait à ce moment une petite étude sur les œufs et les maladies cardiovasculaires, qui échouait à établir un lien, mais elle était trop petite. Il me semblait quand même que pour donner des conseils alimentaires il fallait se baser sur des preuves, sinon on risquait de se tromper. L’Étude des infirmières s’est révélée une bonne opportunité d’obtenir les preuves qui nous manquaient. Elle incluait plus de 100 000 participantes motivées qui étaient capables de délivrer des données de grande qualité. À la fin des années 1970 j’ai commencé une étude pilote pour tester des questionnaires alimentaires standardisés. Et dans les années 1980, après des séries d’études pilotes, nous avons distribué aux participantes les premiers questionnaires alimentaires.
À l’origine cette étude se focalisait sur les contraceptifs oraux et le cancer du sein, avec quelques questions supplémentaires sur le tabac, le poids, etc. C’était une étude qui avait assez peu d’envergure. En ajoutant l’aspect nutritionnel, il est devenu évident qu’il fallait aussi considérer l’activité physique et aussi la consommation d’alcool. L’alcool étant une question sensible, nous l’avons noyée au milieu de questions sur les boissons en général. Ainsi, nous avons comblé les manques de l’étude initiale, nous permettant d’obtenir une meilleure image du mode de vie des participantes.
C’est difficile à dire. Cette étude a été partie prenante de mon expérience de doctorant. En post-doctorat, j’ai continué à pratiquer la médecine interne au Centre de santé de Boston Est pour nourrir ma famille. J’aurais pu poursuivre cette voie clinique que j’aimais beaucoup mais j’ai réalisé que je ne pourrais devenir le médecin que je voulais être sans être en même temps un chercheur de pointe. C’était un objectif certainement au-delà de mes capacités car ces deux activités sont très exigeantes.
En médecine interne, je voyais encore et encore les mêmes problèmes : insuffisance cardiaque, hypertension, diabète. C’était frustrant quelque part car ces affections ne peuvent être vraiment guéries. Vous pouvez aider les patients à garder une bonne qualité de vie sur un temps long mais il me semblait plus important de chercher à prévenir ou à retarder la survenue de ces maladies.
Oui, un long chemin a été parcouru pour ces maladies. Par exemple, nous avons publié une étude dans le New England Journal of Medicine qui montrait que des changements modérés dans le mode de vie et l’alimentation permettaient de prévenir 80% des maladies cardiovasculaires, et dans une autre étude, 90% des diabètes de type 2. Ces affections sont donc largement évitables. Pour le cancer du sein, on a obtenu des pourcentages plus bas mais nos données ont permis de vraiment mieux comprendre sur quels facteurs de risque de ce cancer on pouvait intervenir en prévention. Concernant le cancer colorectal, on sait désormais que la majorité de ces cancers peut être prévenu grâce à l’alimentation et le mode de vie.
Donc oui, nous avons fait un long chemin et l’espérance de vie a bien augmenté depuis les années 1960. Les taux de mortalité cardiovasculaire et de maladie cardiaque ont baissé de plus de 60% depuis cette époque. Mais il existe encore un large fossé entre ce que l’on sait et ce qui est mis réellement en pratique concrètement. Dans l’article qui montrait que 80% des maladies cardiovasculaires pouvaient être évitées, il était souligné aussi que seulement 4% des participantes de l’étude avaient adopté un mode de vie protecteur. Il existe donc de grands écarts entre le potentiel de prévention et la réalité, des écarts accrus par les différences de niveau de vie dans la population. En d’autres termes, si on a fait des progrès considérables, il reste encore beaucoup à apprendre et à mettre en pratique.
Propos recueillis par Alvin Powell pour la gazette de Harvard, traduits par Priscille Tremblais en exclusivité pour LaNutrition.fr. Reproduits avec l'aimable autorisation de l'auteur.
Les meilleurs livres et compléments alimentaires sélectionnés pour vous par NUTRISTORE, la boutique de la nutrition.
Découvrir la boutique
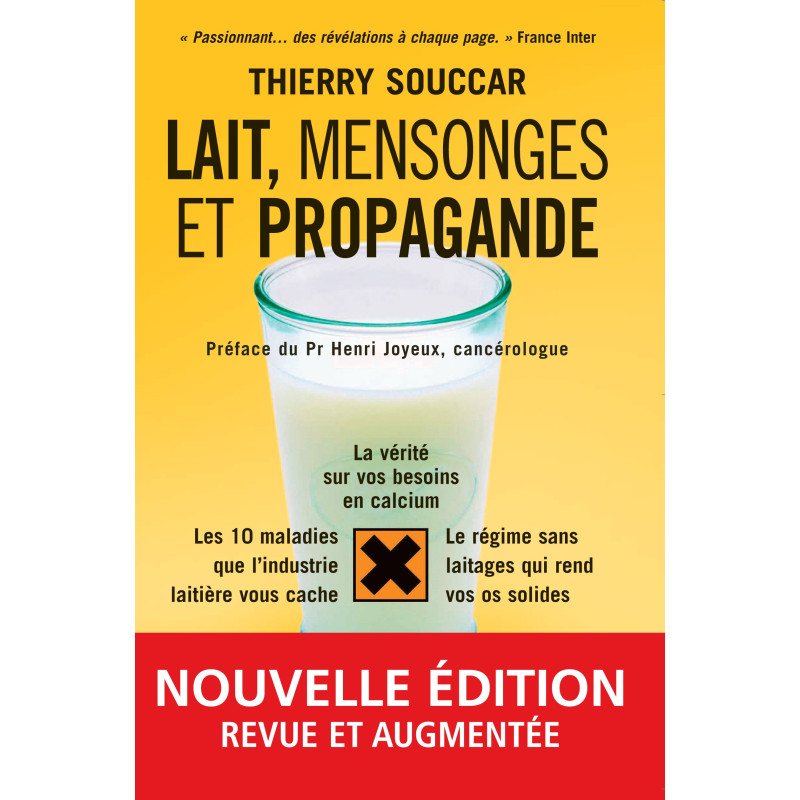

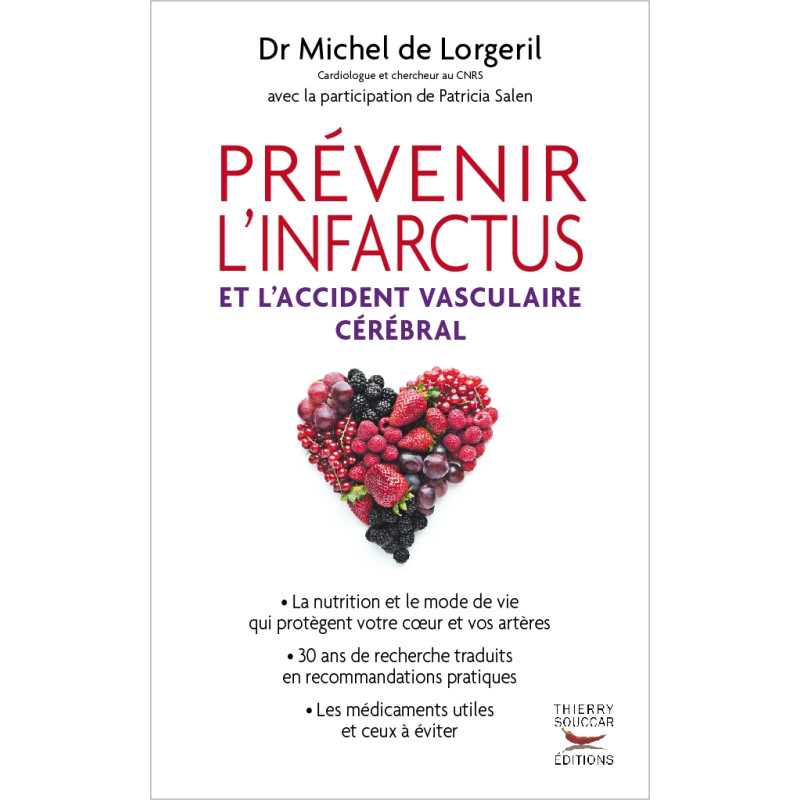

Le foie est un organe essentiel à la vie. Mais parfois il est fatigué et ne remplit plus correctement ses fonctions. Quels sont les meilleurs aliments pour préserver la santé de son foie ? Nous vous en détaillons 10.

Pour la planète comme pour la santé, il est préférable d’utiliser les fruits et légumes de saison. Voici la liste des fruits et légumes d'avril que l’on retrouve en France, leurs vertus santé et des recettes pour les accommoder.

Pour la planète comme pour la santé, il est préférable d’utiliser les fruits et légumes de saison. Voici la liste des fruits et légumes de mars que l’on retrouve en France, leurs vertus santé et des recettes pour les accommoder.