Répondez à un questionnaire, et repérez-vous sur la carte de la personnalité construite à partir du modèle de Cloninger.


C. Robert Cloninger a formulé il y a 30 ans l’hypothèse que le tempérament est sous commande de 3 principaux neurotransmetteurs : dopamine, sérotonine, noradrénaline. Explications.
À l’origine, le Pr Cloninger a associé chaque trait de tempérament à un neurotransmetteur principal. Cette classification, qui a obtenu confirmation dans plusieurs études, mais...
Retrouvez la suite de votre article en vous connectant à votre espace personnel.
Je m'identifieAccédez à des articles et conseils exclusifs en vous abonnant pour seulement 39 € / an.
Je m'abonneLes meilleurs livres et compléments alimentaires sélectionnés pour vous par NUTRISTORE, la boutique de la nutrition.
Découvrir la boutique
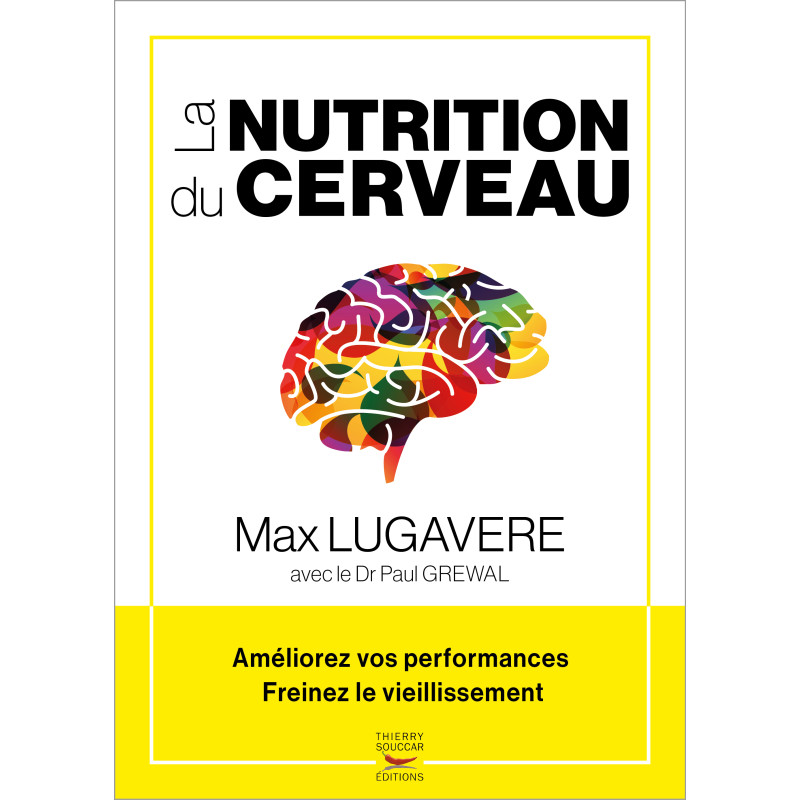
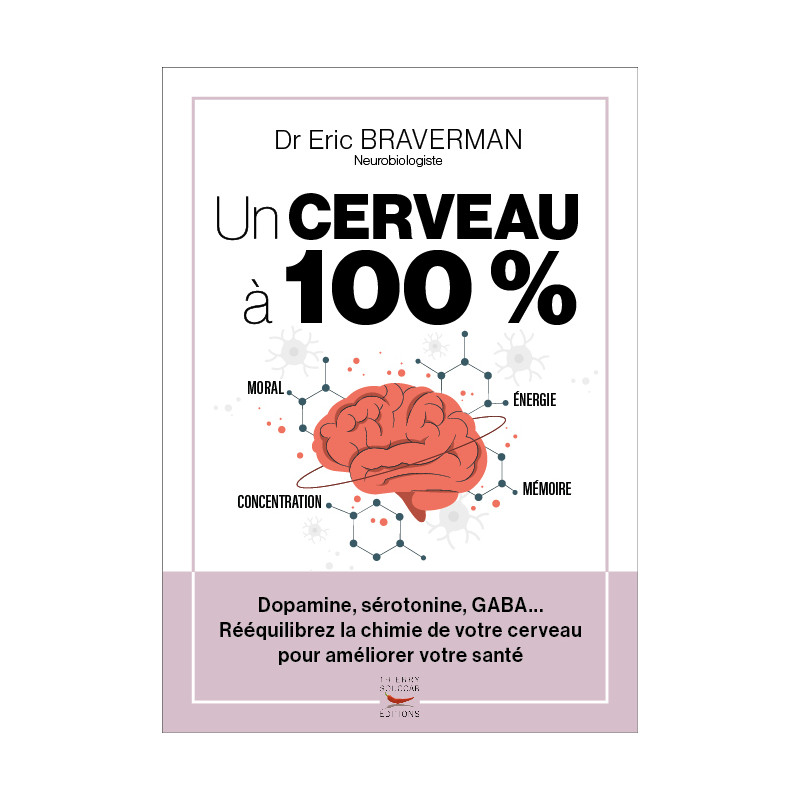
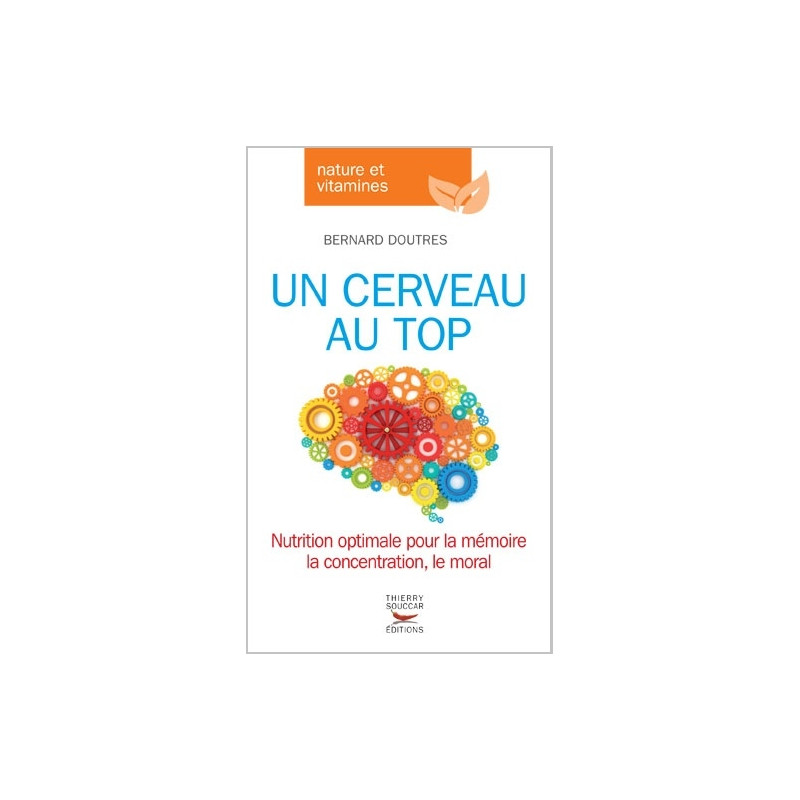
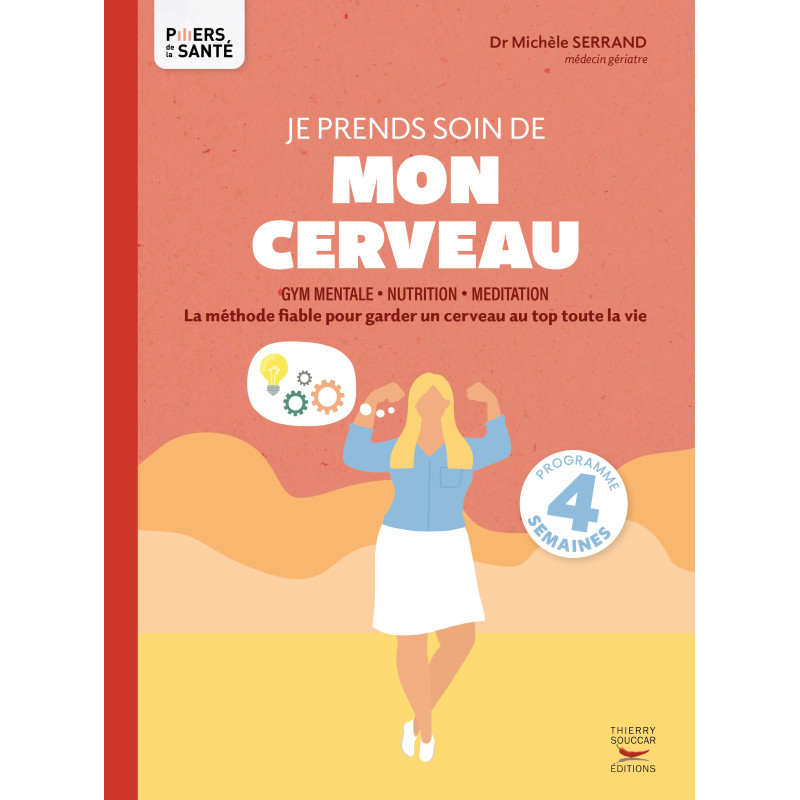

Répondez à un questionnaire, et repérez-vous sur la carte de la personnalité construite à partir du modèle de Cloninger.

Êtes-vous aventurier ou timoré ? Ambitieux ou velléitaire ? Ordonné ou confus ? Les recherches sur la personnalité permettent de mieux comprendre les influences de l’hérédité et de l’environnement sur le tempérament et le caractère.

Vous prenez un faux médicament et vous êtes guéri : voici ce qu'est l'effet placebo. Quels sont ses mécanismes ? De quelles données chiffrées disposons-nous sur ce phénomène ?