Avec la nouvelle année a sonné l’heure des bonnes résolutions. En 2023, il est urgent de continuer à réduire nos déchets.


Qu’entend-on par produit local ? Comment s’y retrouver sans se faire avoir ? Et quels sont les bienfaits réels de ce mode de consommation? La Nutrition.fr fait le point avec Yuna Chiffoleau, directrice de recherche en sociologie à l’Institut national de la recherche agronomique et de l’environnement (INRAE).
Yuna Chiffoleau : Cette notion n’est pas officiellement définie mais elle commence à se stabiliser, tout en restant très liée au produit. Pour les fruits et légumes, on se situe plutôt à l’échelle du département alors que pour la viande ou les céréales, on élargit souvent le « local » au périmètre des ex-régions, parce qu’il y a besoin de transformation.
Dans une enquête nationale réalisée en 2013, nous avons observé que plus de la moitié des consommateurs associaient effectivement circuit court et bio et 95%, circuit court et local. Officiellement la définition du circuit court proposée par l’Etat depuis 2009 n’englobe pas la notion de distance : elle repose sur la limitation à un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur. Sur le terrain, c’est tout de même bien des circuits de proximité qui se développent, en partie grâce aux collectivités qui les mettent en place en privilégiant les productions qui font vivre leur territoire.
On trouve cinq fois plus de producteurs bio dans les circuits courts (10%) que dans les filières longues (seulement 2%). En terme de dynamique, les circuits courts, notamment en vente directe, enclenchent une écologisation des pratiques agricoles parce que les producteurs sont davantage au contact des consommateurs et comprennent que c’est une attente de leur part.
Le vrai déclencheur c'est la crise de la vache folle à la fin des années 1990. Une méfiance s’est installée vis-à-vis des systèmes de garantie de l'Etat qui se sont révélés faillibles. Pour se rassurer, les gens ont cherché à connaître l’origine des produits ou bien sont allés directement chez le producteur.
Il y a eu un effet de mode au départ pour une population éduquée, aujourd’hui c'est un effet structurant. En 2013, 42 % des Français avaient utilisé un circuit court durant le mois qui précédait notre enquête et les circuits courts représentaient alors 10% des achats alimentaires. Aujourd’hui, on estime que deux tiers des Français ont recours à ces circuits et que cela représente plus de 15 % des achats alimentaires. On est dans un mouvement d'ouverture et de démocratisation. Il y a aussi un patriotisme économique qui touche les gens plus modestes qui le portent pour la défense des emplois et de l'économie, avec parfois un risque de repli sur soi ou de récupération nationaliste.
Lire aussi : L’impact de l’alimentation des Français sur l’environnement est important
Les deux. Il y a un regain d'intérêt pour les marchés de plein vent, plutôt fréquentés par des jeunes et des classes moins aisées parce que c'est un circuit court qui n'est pas engageant. Il y a les marchés de producteurs, les AMAP plus engagées et militantes, les groupements d’achats… On trouve aussi des choses nouvelles comme les supermarchés coopératifs et, bien sûr, le boum des plateformes internet. Nous appelons les consommateurs à être vigilants, il y a beaucoup d'opportunisme et des produits qui font semblant d’être locaux et sont très chers. Ce qui est intéressant c'est que la France est le pays où on trouve la plus grande diversité de circuits courts en Europe.
Le local seul n’est pas une garantie de qualité, de durabilité ou de soutien à l’agriculture locale. La grande distribution et les grandes entreprises profitent du flou pour relocaliser les filières longues mais sans changer la gouvernance, sans permettre le lien producteur-consommateur. Au-delà de quelques partenariats avec des producteurs locaux, qui servent de vitrine, on observe toujours la même iniquité, la même pression sur le reste de leurs fournisseurs.
C’est compliqué car très opaque pour le consommateur qui a difficilement accès aux cahiers des charges. La plupart des marques territoriales sont très laxistes, et entretiennent le flou sur l’origine des matières premières. Le produit a parfois juste été transformé sur le territoire. Il y a tout de même des marques qui aident à y voir plus clair. L’INRAE est d’ailleurs à l’origine de la démarche « Ici C.Local ». Une marque collective d’usage gratuit qui permet d’identifier facilement avec un code couleur, sur les étals des marchés, les produits locaux issus de circuits courts et respectant un certain nombre de critères de durabilité.
Comme pour le bio, c'est un gros débat et les nutritionnistes n’arrivent pas à se mettre d’accord. Avec un peu de bon sens on voit quand même qu’en circuit court le produit voyage moins ce qui garantit la fraîcheur et donc les vitamines. En tant que sociologue, ce qui m’intéresse davantage, c’est l’esprit du circuit court. Toutes les remontées d'études indiquent que l’on trouve peu ou pas d’additifs ou de conservateurs dans les produits transformés en circuits courts. Les producteurs et artisans respectent davantage l’intégrité des matières premières et privilégient les technologies douces de transformation. C’est particulièrement vrai pour le pain.
Il y a potentiellement un effet transformateur sur les pratiques alimentaires mais tout dépend de la pédagogie. La vente directe a un véritable impact si le producteur est capable de raconter ce qu'il y a derrière le produit, si le consommateur redécouvre ce qu'est l'agriculture, la transformation des produits agricoles. S'il y a de la pédagogie, une valorisation du manger mieux, si ce n'est pas trop imposé, trop injonctif alors oui, on peut observer un changement des pratiques alimentaires. Y compris chez un public moins attendu, parce que moins aisé ou moins éduqué.
Oui, car on passe par le rapport-qualité prix donc on se dit : « J’en mange moins mais de meilleure qualité ». C’est particulièrement vrai pour la viande et de manière générale cela se répercute sur une plus grande consommation de légumes.
C’était vrai en Amap où on pouvait avoir du chou tout l'hiver mais elles se sont adaptées et ont diversifié leur production en recourant à des espèces oubliées et à des variétés anciennes. Là encore, si le producteur donne des recettes, s’il explique comment cuisiner, cela passe mieux. On en revient à la pédagogie.
L’enquête de 2013 montrait que le prix était un frein pour ceux qui n'achetaient pas encore en circuits courts. Ceux qui achetaient déjà raisonnaient davantage en rapport qualité-prix. Et si on compare à qualité égale, les produits en circuits courts sont moins chers qu’au supermarché. Dans le prix, il faut également tenir compte des conséquences sur l'emploi et sur l'environnement : un prix bas signifie le plus souvent une agriculture mécanisée et intensive.
La logistique reste un point faible dans les circuits courts. Les critiques sur ce système sont apparues dès 2006 arguant qu'il valait mieux faire venir de l'agneau de Nouvelle-Zélande par cargo que du centre de la France en voiture. Mais il ne faut pas uniquement ramener le coût carbone au kilo de produit, il faut aussi le mettre en perspective avec la densité nutritionnelle du produit, les euros que cela rapporte au producteur, l'emploi que cela crée. Selon le recensement agricole, une ferme en circuit court emploie deux fois plus de personnes à l’hectare qu'une ferme en circuit long. Il faut considérer aussi la préservation des nappes phréatiques, le maintien de la biodiversité, la contribution aux paysages, bref tout un ensemble d'autres indicateurs, mais c’est vrai qu’il y a un travail à faire.
La sécurité alimentaire des villes est effectivement une toute nouvelle question. On montre que c'est la coexistence des origines, des circuits qui fait la résilience. Mais la coexistence on n’y est pas encore et donc il faut rééquilibrer. Les collectivités commencent à le comprendre et s'engagent. C’est devenu un argument supplémentaire en faveur du local.
Cela tient à cette dimension pédagogique. Comprendre comment est fixé le prix d'un légume c'est mieux comprendre le fonctionnement économique en général. Les circuits courts redonnent une dimension citoyenne au consommateur avec parfois des formes qui sont d'emblée démocratisantes. Je ne dis pas que tous les circuits courts sont capables de cela mais la diversité fait que c'est possible.
Propos recueillis par Lucie Lecherbonnier.
Deux livres pour aller plus loin : Le guide de l'alimentation durable et La nutriécologie
Les meilleurs livres et compléments alimentaires sélectionnés pour vous par NUTRISTORE, la boutique de la nutrition.
Découvrir la boutique
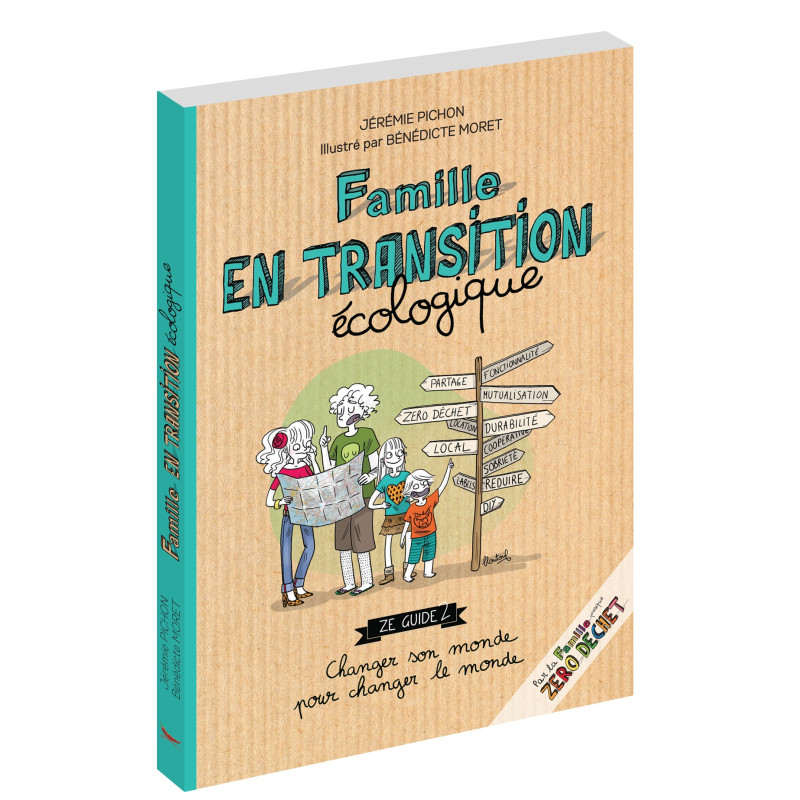
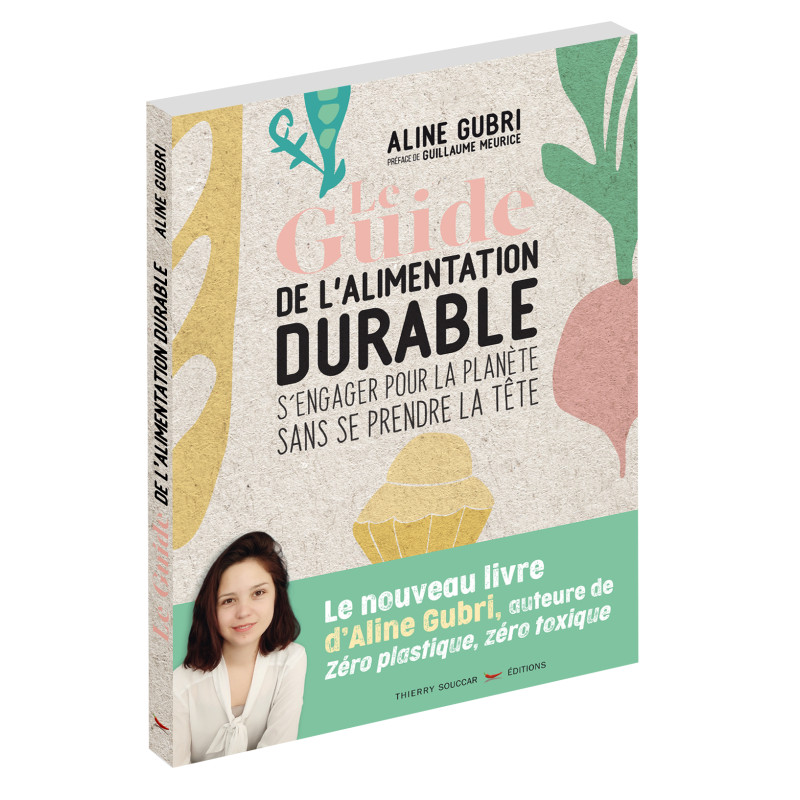

Avec la nouvelle année a sonné l’heure des bonnes résolutions. En 2023, il est urgent de continuer à réduire nos déchets.

Dans le cadre de la Semaine européenne de sensibilisation à la réduction des déchets, LaNutrition vous détaille 4 changements que vous pouvez apporter dans votre quotidien pour rendre votre mode de vie plus écologique. A vous de choisir lequel adopter en priorité.

Que diriez-vous de conserver les graines pour ne pas avoir à en racheter au printemps prochain ? Voici les clés pour récupérer et conserver les semences de vos plantes potagères.