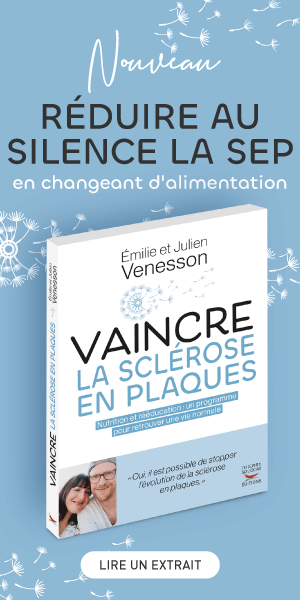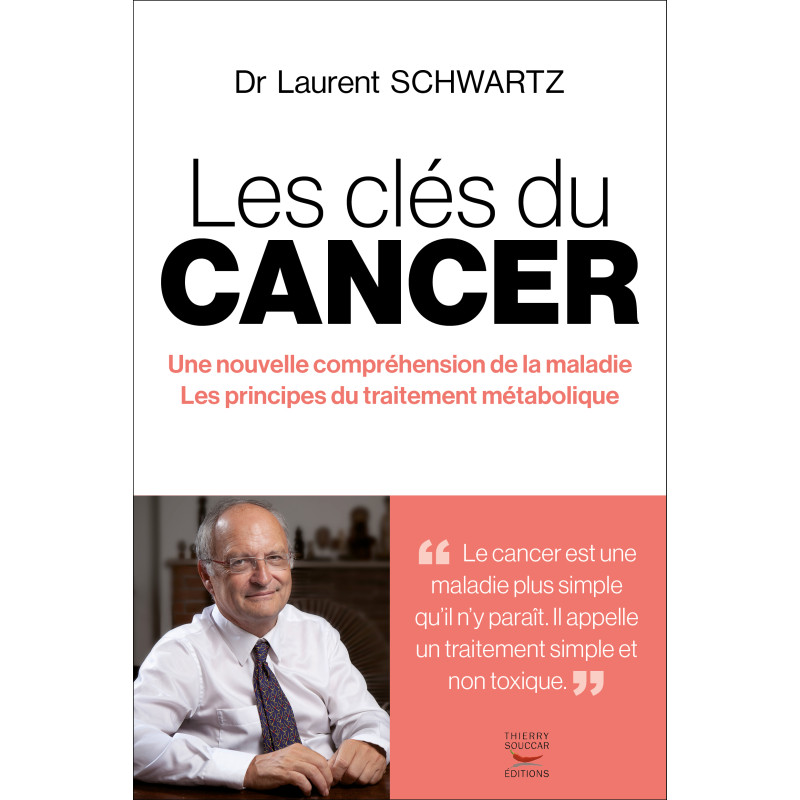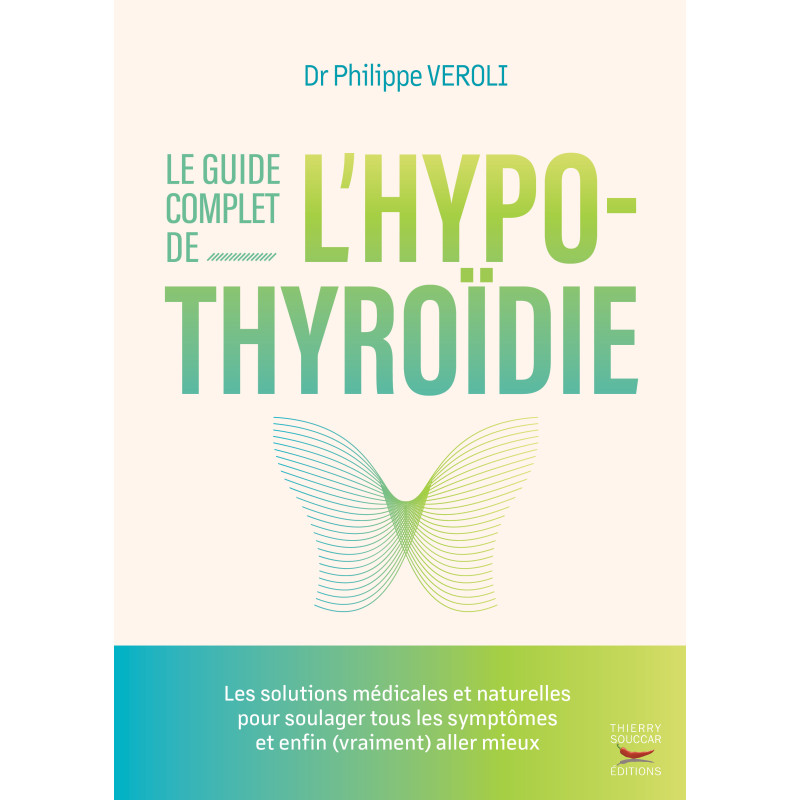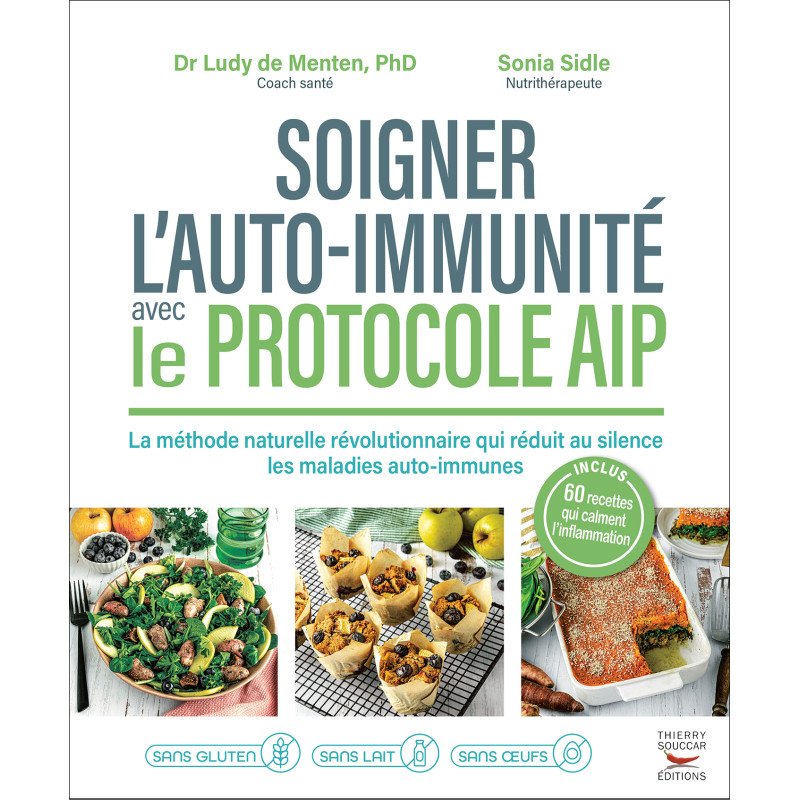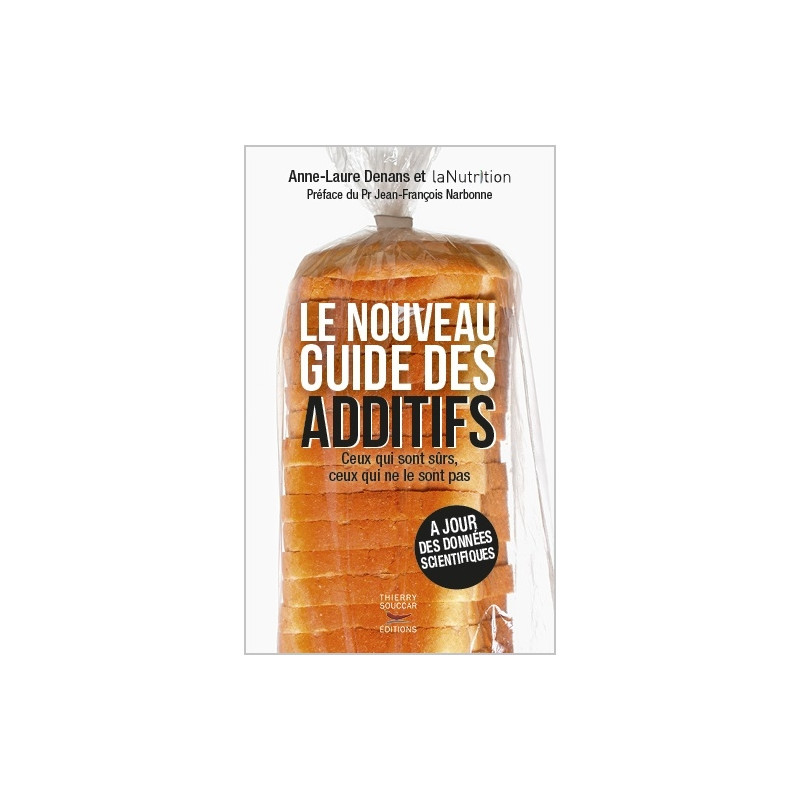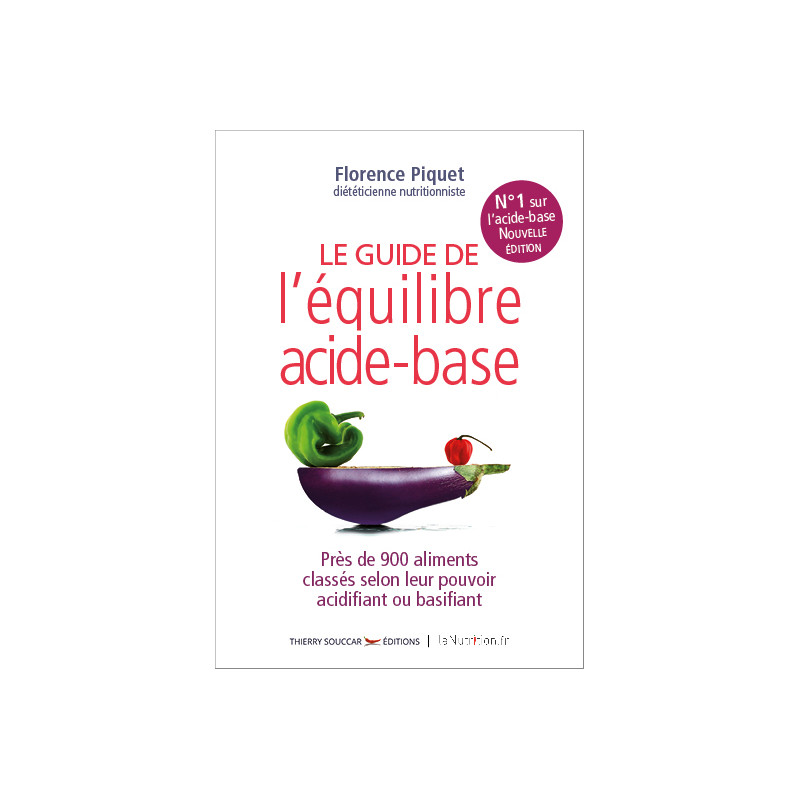Nausées, œdème de Quincke, atteinte hépatique, dépression, troubles de la vision... Lire la rubrique « effets indésirables » des notices de médicaments peut se révéler inquiétant. D’autant que la prise de ces produits peut également provoquer des effets non répertoriés sur la notice. En France, les autorités de santé ont déclaré 17 000 cas d’effets indésirables pour l’année 2000. Pourtant lors d’une audition au Sénat, Jacques Caron, le président de la commission nationale de pharmacovigilance de l'Afssaps, admet que ces chiffres « ne donnent qu’une image partielle de la situation ». En effet, une enquête a été menée en 1998 dans les hôpitaux français, faisant état de… 128 000 hospitalisés par an pour cause d’effets indésirables, soit un peu plus de 3 % des hospitalisations annuelles. « Ils causeraient de 10 000 à 30 000 décès par an », estime Patrice Queneau, président d’honneur de l’APNET (Association Pédagogique Nationale pour l’Enseignement de la Thérapeutique).
Les études sur le sujet sont peu nombreuses, d’où la difficulté d’obtenir des chiffres représentatifs de la réalité. En milieu hospitalier, on estime que ces effets indésirables surviennent chez environ 10 % des patients. Un tiers à la moitié d’entre eux sont considérés comme graves.
Ces chiffres sont comparables à ceux observés chez d’autres pays développés. Pourtant dans environ la moitié des cas, ces accidents sont évitables. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils sont dus à des erreurs humaines.
 Mais les professionnels de santé ne sont pas les seuls fautifs ! Les malades ont aussi leur part de responsabilité. Elle a même été chiffrée en 2003, dans une étude prospective de l’APNET sur 1937 patients hospitalisés. Résultat, la moitié des effets indésirables évitables sont provoqués par le patient. En cause, une mauvaise observance des traitements, un arrêt trop brutal ou une mauvaise automédication. Côté soignants, la faute incomberait à de mauvaises prescriptions ou un manque de surveillance et de suivi à l’hôpital. Typiques des prescriptions erronées, les associations dangereuses de médicaments. Le risque de subir un effet secondaire est de 9,5 % pour un patient qui prend un seul produit. Il passe à 19,4 % avec deux à quatre médicaments puis jusqu’à 35,6 % pour dix médicaments ou plus.
Mais les professionnels de santé ne sont pas les seuls fautifs ! Les malades ont aussi leur part de responsabilité. Elle a même été chiffrée en 2003, dans une étude prospective de l’APNET sur 1937 patients hospitalisés. Résultat, la moitié des effets indésirables évitables sont provoqués par le patient. En cause, une mauvaise observance des traitements, un arrêt trop brutal ou une mauvaise automédication. Côté soignants, la faute incomberait à de mauvaises prescriptions ou un manque de surveillance et de suivi à l’hôpital. Typiques des prescriptions erronées, les associations dangereuses de médicaments. Le risque de subir un effet secondaire est de 9,5 % pour un patient qui prend un seul produit. Il passe à 19,4 % avec deux à quatre médicaments puis jusqu’à 35,6 % pour dix médicaments ou plus.
La quantité est donc à prendre en compte, mais aussi le type de molécules. Certaines sont plus susceptibles de provoquer ces effets. Au banc des accusés, selon l’étude de l’APNET, les psychotropes (20,5 %), les médicaments cardiovasculaires (15,4 %), les antalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (13,9 %), les diurétiques (11,7 %) et les anticoagulants (9,3 %). De son côté, l'association d'aide aux victimes des accidents et maladies liés aux risques des médicaments (AAAVAM) reçoit de nombreux témoignages concernant les effets indésirables des tranquilisants et des somnifères, de certains antibiotiques (quinolones et fluoroquinolones), des anti-cholestérols (Zocor®, Tahor®), d’un produit contre les bouffées de chaleur de la ménopause nommé Agréal®, etc.
Des erreurs qui coûtent chers, en terme de santé publique comme de dépenses financières. Il y a 10 ans, elles ont été estimées à 1,2 % de la dotation globale hospitalière. En 1998, l’ensemble des hospitalisations pour cause d’effets secondaires a coûté 335 millions d’euros, soit environ 2 500 euros par hospitalisation. La même année, le coût des événements iatrogènes hospitaliers évitables était estimé à 4 % des dépenses nationales de santé aux Etats-Unis.
Des essais cliniques biaisés
Décès, coûts prohibitifs, ces effets indésirables représentent un problème majeur de santé publique. Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ne les prévoient ni ne les maîtrisent-ils pas ? Début de réponse dans les méandres de la création d’un médicament.
Avant d’être commercialisée et d’obtenir son autorisation de mise sur le marché (AMM), chaque nouvelle molécule passe plusieurs tests. S’ils sont franchis avec succès, la candidate obtiendra le droit de figurer dans les rayonnages des pharmacies.
| Les essais cliniques |
|
Déterminer l’efficacité d’un médicament. Tester son mode d’action, sa toxicité. Tels sont les paramètres qui doivent être étudiés avant que le candidat médicament n’obtienne le droit de figurer dans les rayonnages des pharmacies.
Après des premiers résultats sur des cellules in vitro et les expériences sur les animaux, le laboratoire débute les essais cliniques sur l’homme. Très codifiés, ces tests sont soumis à des règles et à une législation, notamment la loi Huriet du 20 décembre 1988 dans le cas de la France. Elle oblige par exemple le laboratoire à obtenir le consentement écrit des personnes participantes. Elle réglemente également le nombre d’essai qu’un volontaire peut pratiquer et la rémunération qu’il peut en retirer.
Divisés en trois étapes, les essais cliniques s’effectuent au début sur des volontaires en bonne santé, puis sur des malades.
La première phase s’effectue sur un échantillon de 20 à 100 personnes saines, pendant 11 à 21 mois. Elle consiste à observer la tolérance à des doses de plus en plus élevées : la molécule est-elle toxique et à quelle dose ? Il s’agit en plus de déterminer la façon dont le corps transforme et élimine la molécule.
Dans la phase II, on recherche la posologie efficace et les propriétés exactes du médicament. Elle dure entre 14 et 35 mois et porte sur 100 à 1 000 patients. Le laboratoire va, par exemple, déterminer s’il existe des interactions entre le produit et l’alimentation.
Enfin, la phase III doit faire la preuve que le médicament est aussi efficace ou supérieur à un produit déjà existant et qu’il est bien toléré par l’organisme. Elle s’effectue sur 1 000 à 5 000 patients pendant 35 à 55 mois. Certains reçoivent un placebo ou un produit de référence dont on connaît bien les effets, d’autres prennent la nouvelle molécule. Cette méthode compare les effets de l’un et de l’autre et ainsi donne une preuve de l’efficacité du médicament. Cela permet d’évaluer les éventuels effets secondaires et de se rapprocher de la réalité du terrain.
Au terme de ces trois étapes, le laboratoire va communiquer les études à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ou à l’EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du médicament. Après cet agrément un dernier stade se met en place. Il s’agit d’un suivi à long terme, qui n’implique plus de tests sur des personnes. Appelée pharmacovigilance, cette phase a notamment pour but d’étudier les effets inattendus du médicament, tout au long de sa « vie ».
|
 Mais c’est avec ces essais cliniques que le bât blesse : ils ne peuvent durer indéfiniment. Or certains effets n’apparaissent qu’au bout de plusieurs mois ou années d’un traitement continu. Il y a donc forcément un manque de données sur le long terme. D’autre part, les patients sont véritablement sélectionnés pour les tests. Ils ont tous le même profil, ne prennent aucun autre médicament et sont très surveillés. Après cette sélection draconienne, cette population testée n’est plus très représentative de celle qui utilisera le produit. Ainsi sont généralement exclus les personnes âgées et les enfants. Claude Huriet, président de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a indiqué lors d’une audition au Sénat que « les neuf dixièmes des médicaments administrés aux enfants sont prescrits hors du champ défini par l'AMM ». En d’autres termes, les doses à administrer aux enfants n’ont pas été définies ni contrôlées avant la commercialisation du produit. Problème, un corps d’enfant ou de prématuré, dont le foie et les reins sont immatures, ne réagit pas de la même façon que celui d’un volontaire sélectionné. Même remarque avec un corps de personne âgée. Un exemple frappant, celui du diazepam (Valium®). Le diazepam est une molécule lipophyle, qui s’accumule dans les tissus gras et est évacuée beaucoup plus lentement chez le patient âgé. Selon un rapport de l’Académie nationale de Pharmacie (2005), elle va être éliminée de moitié au bout d’une journée à l’âge de 20 ans, alors qu’il faudra 3 jours chez une personne de 70 ans. La posologie indiquée suite aux essais cliniques effectués sur des patients d'âge moyen est donc inadaptée aux malades âgés et risque d’augmenter les effets indésirables (chutes, anxiété, dépression...). Or cette dernière population est justement la plus grande consommatrice de médicaments : en 2001, les plus de 65 ans consommaient 39 % des médicaments prescrits en ville (données CNAMTS). Ils sont aussi plus souvent victimes d’effets secondaires, ce que constate une étude française menée en 2002. Après 65 ans, les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents et 10 à 20 % d’entre eux conduisent à une hospitalisation.
Mais c’est avec ces essais cliniques que le bât blesse : ils ne peuvent durer indéfiniment. Or certains effets n’apparaissent qu’au bout de plusieurs mois ou années d’un traitement continu. Il y a donc forcément un manque de données sur le long terme. D’autre part, les patients sont véritablement sélectionnés pour les tests. Ils ont tous le même profil, ne prennent aucun autre médicament et sont très surveillés. Après cette sélection draconienne, cette population testée n’est plus très représentative de celle qui utilisera le produit. Ainsi sont généralement exclus les personnes âgées et les enfants. Claude Huriet, président de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a indiqué lors d’une audition au Sénat que « les neuf dixièmes des médicaments administrés aux enfants sont prescrits hors du champ défini par l'AMM ». En d’autres termes, les doses à administrer aux enfants n’ont pas été définies ni contrôlées avant la commercialisation du produit. Problème, un corps d’enfant ou de prématuré, dont le foie et les reins sont immatures, ne réagit pas de la même façon que celui d’un volontaire sélectionné. Même remarque avec un corps de personne âgée. Un exemple frappant, celui du diazepam (Valium®). Le diazepam est une molécule lipophyle, qui s’accumule dans les tissus gras et est évacuée beaucoup plus lentement chez le patient âgé. Selon un rapport de l’Académie nationale de Pharmacie (2005), elle va être éliminée de moitié au bout d’une journée à l’âge de 20 ans, alors qu’il faudra 3 jours chez une personne de 70 ans. La posologie indiquée suite aux essais cliniques effectués sur des patients d'âge moyen est donc inadaptée aux malades âgés et risque d’augmenter les effets indésirables (chutes, anxiété, dépression...). Or cette dernière population est justement la plus grande consommatrice de médicaments : en 2001, les plus de 65 ans consommaient 39 % des médicaments prescrits en ville (données CNAMTS). Ils sont aussi plus souvent victimes d’effets secondaires, ce que constate une étude française menée en 2002. Après 65 ans, les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents et 10 à 20 % d’entre eux conduisent à une hospitalisation.
Autant de raisons qui expliquent l’insuffisance des essais cliniques à recenser l’ensemble des effets indésirables potentiels.
Les industriels sous pression
Mais les essais cliniques incomplets ne sont pas les seuls coupables. Un autre suspect, moins avouable, intervient dans l’équation : l’aspect financier. Sous pression, les laboratoires pharmaceutiques passent parfois sous silence des résultats négatifs concernant leur molécule, ou refusent d’admettre les dégâts causés. Régulièrement, des cas graves viennent étayer cette affirmation (lire le cas de la thalidomide ci-dessous et l'article de LaNutrition.fr sur le Vioxx). Car le retrait d’un médicament signe une perte financière conséquente pour les fabricants. Ainsi, début décembre 2006, des essais cliniques concernant un nouveau traitement du cholestérol nommé torcetrapib ont été interrompus pour cause de décès trop nombreux chez les patients. Deux jours plus tard, le cours de l’action du fabricant a chuté de 15 % . Car trouver une nouvelle molécule prend du temps, et de l’argent. Il faut environ 13 ans de recherche pour que le médicament parvienne sur les rayonnages des pharmacies. Autant de temps pendant lequel il ne rapporte rien mais coûte beaucoup. Selon un rapport du LEEM (Les entreprises du médicament), syndicat de l’industrie pharmaceutique française, « tout décalage dans le démarrage effectif de l’exploitation des brevets a un effet négatif considérable sur le résultat d’exploitation. Un calcul approximatif suggère qu’un an de décalage du début de la période de commercialisation est susceptible de faire disparaître une large partie de la rentabilité attendue d’un médicament ». Et les profits se comptent en milliards d’euros. En 2005, le chiffre d’affaire de l’industrie pharmaceutique en France s’élevait à 40 milliards d’euros. Selon les Intercontinental Marketing Services (IMS), le principal fournisseur privé de données sur le secteur pharmaceutique, le marché mondial du médicament était de 400 milliards de dollars en 2002.
Autre motif d’inquiétude pour les laboratoires, l’arrivée à échéance des brevets de certains médicaments-phares. D’ici trois ans, les « recettes de préparation » de 42 médicaments passeront dans le domaine public. Ils vont donc pouvoir être concurrencés par des génériques. Or ce ne sont pas n’importe quelles molécules. A elles seules, elles représentent un chiffre d’affaires de 80 milliards de dollars, soit le quart du marché mondial. Les laboratoires doivent donc mettre les bouchées doubles pour en élaborer de nouvelles. Sachant que cette course à la performance a quelquefois des effets désastreux.
Ce fut notamment le cas de la thalidomide au début des années 1960, mais il est loin d’être le seul. Régulièrement, des médicaments sont retirés du marché après des rapports concernant des effets secondaires graves. Ce fut récemment le cas du Vioxx ou celui du distilbène, une hormone de synthèse commercialisée de 1950 à 1977 en France. Elle était prescrite aux femmes pendant la grossesse pour prévenir les fausses couches. Ce médicament s'est révélé nocif pour les enfants exposés in utero, notamment les filles. Il a causé des malformations génitales qui provoquent de grandes difficultés à être enceinte et à mener une grossesse à terme (grossesses extra-utérines, fausses couches, grande prématurité ...). Ces filles ont aussi un risque plus élevé de développer des cancers du vagin et du col de l’utérus.
Les techniques de pharmacovigilance sont insuffisantes
 A posteriori, des contrôles existent donc. Ils sont mis en place dès la commercialisation du médicament. Après la délivrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché, une dernière étape se met en place. Il s’agit d’un suivi à long terme, qui n’implique plus de tests sur des personnes. Cette pharmacovigilance a notamment pour but d’étudier les effets inattendus du médicament, tout au long de sa « vie ».
A posteriori, des contrôles existent donc. Ils sont mis en place dès la commercialisation du médicament. Après la délivrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché, une dernière étape se met en place. Il s’agit d’un suivi à long terme, qui n’implique plus de tests sur des personnes. Cette pharmacovigilance a notamment pour but d’étudier les effets inattendus du médicament, tout au long de sa « vie ».
En France, le système repose sur les professionnels de santé. Depuis 1984, médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ont l’obligation de déclarer tout effet graves ou inattendus constatés, mais tout autre professionnel de santé peut également effectuer cette déclaration. Cette « notification spontanée » repose sur la confiance. Personne ne viendra contrôler les praticiens. Ils disposent d’un formulaire particulier, qui recense des informations sur le malade (âge, sexe, antécédents…), les effets secondaires observés, le ou les médicaments potentiellement responsables et les coordonnées du notificateur. Une fois rempli, ils le transmettent au fabricant du médicament ou bien à leur centre régional de pharmacovigilance. Créés en 1974, ces 31 centres sont répartis dans toute la France et implantés dans des centres hospitaliers universitaires (CHU). A l’arrivée de la fiche, les médecins et pharmaciens recueillent et analysent les données. Ils doivent déterminer s’il y a effectivement un lien entre le médicament et l'effet secondaire. Pas toujours évident, surtout quand le patient prenait plusieurs produits en même temps. Si l’association semble vraisemblable, les responsables vont alimenter une base de données nationale, gérées par l’Afssaps. Différents comités et commissions de pharmacovigilance vont ensuite déterminer l’utilité d’une enquête et lancer des études détaillées. Au terme de ces procédures, l’Afssaps décide le retrait ou le maintien du médicament sur le marché. Entre 1998 et 2004, 21 médicaments ont ainsi été interdits.
Le fabricant du produit a lui aussi des obligations de pharmacovigilance. Tout accident de santé lié à la prise de médicament est signalé dans un délai obligatoire à l’Afssaps. Les entreprises remettent également des rapports réguliers sur le suivi du médicament. Tous les 6 mois pendant les deux premières années, tous les ans pendant les 3 années suivantes, enfin tous les 5 ans tant que le médicament est commercialisé. Mais les firmes pharmaceutiques font également preuve d’initiatives dans ce domaine. Au mois de septembre 2005, la Fédération Internationale de l’Industrie du Médicament (FIIM) a créé un portail Internet (http://clinicaltrials-dev.ifpma.org/) donnant accès aux essais cliniques en cours ainsi qu’à ceux déjà terminés. Le Dr Daniel Vasella, Président Directeur Général de Novartis et Président de la FIIM a déclaré que ce portail international « était destiné à fournir aux médecins, aux patients et à leurs famille un accès simple à l’information la plus complète qui existe sur les essais cliniques portant sur les médicaments et les vaccins. Le lancement de ce portail montre bien l’engagement de l’industrie pharmaceutique en faveur d’une transparence totale, dans l’intérêt des patients et des professionnels de santé ».
Au niveau européen, l’EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) chapote un réseau de 25 systèmes nationaux. Tous participent au Groupe de travail européen de pharmacovigilance (Pharmacovigilance Working Party, PhVWP) et alimentent une base de données commune. Bonne élève, la France fournit près de 25 % des informations totales. Autre organisation, celle de l’OMS. 1968 a vu la naissance d’un programme de pharmacovigilance international. Il regroupe aujourd’hui 86 pays qui mettent en commun leurs informations concernant les effets indésirables.
 Malgré tout, ce système de signalisation reste insuffisant. Le nombre de notifications spontanées est largement inférieur aux dégâts causés par les effets indésirables. Il semblerait que les professionnels de santé soient quelques peu réticents à effectuer les démarches nécessaires. Un phénomène qui touche surtout les généralistes et les pharmaciens. Ils ne sont à l’origine que de 8 et 11 % des déclarations d’effets indésirables. Contre 79 % pour les spécialistes. Par négligence, manque de temps, par peur d’être impliqué dans un litige, de paraître incompétent, d’être jugé responsable de la maladie d’un patient... Les raisons ne manquent pas.
Malgré tout, ce système de signalisation reste insuffisant. Le nombre de notifications spontanées est largement inférieur aux dégâts causés par les effets indésirables. Il semblerait que les professionnels de santé soient quelques peu réticents à effectuer les démarches nécessaires. Un phénomène qui touche surtout les généralistes et les pharmaciens. Ils ne sont à l’origine que de 8 et 11 % des déclarations d’effets indésirables. Contre 79 % pour les spécialistes. Par négligence, manque de temps, par peur d’être impliqué dans un litige, de paraître incompétent, d’être jugé responsable de la maladie d’un patient... Les raisons ne manquent pas.
Les solutions, selon un rapport du Sénat concernant les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments, seraient notamment de « sensibiliser les médecins aux enjeux de la pharmacovigilance et aux mécanismes du dispositif public et ce, dès leur formation initiale ». Car aujourd’hui, l'enseignement en pharmacovigilance se limite à deux heures de cours pendant la quatrième année d'études de médecine. Autre point de discussion, la participation des malades eux-mêmes. Aujourd’hui, un patient ne peut pas directement signaler un effet indésirable aux centres de pharmacovigilance. Récemment, une expérience de notification directe a été menée avec des patients séropositifs. Elle n’a pas prouvé son efficacité par rapport au système classique. Autre piste de recherche, la collaboration des autorités de santé et des associations de malades. Depuis 2004, certaines d’entre elles ont d’ailleurs intégré la commission nationale de pharmacovigilance ou exercent déjà un rôle de sécurité sanitaire. C’est le cas de l’AAAVAM, qui recueille les déclarations de victimes sous la forme d’une fiche similaire à celle qu’utilisent les professionnels de santé. Depuis 1992, elle a recueilli 5 000 de ces déclarations, qui sont ensuite envoyées à l’Afssaps. Dans le cas du Vioxx, 200 dossiers ont été transmis, dont 70 confirmés par l’Afssaps.
« Il est extrêmement fastidieux de constituer ces documents », tempête Georges-Alexandre Imbert, le président de l’AAAVAM. « Il y a en France un corporatisme médical effrayant, qui se traduit notamment par des falsifications d’expertises. Nous avons vraiment du mal à obtenir des experts intègres, non liés aux industriels pharmaceutiques concernés ». Aujourd’hui, 15 dossiers « Vioxx » sont actuellement entre les mains d’avocats américains. En jeu, une action collective contre le laboratoire Merck, fabricant du Vioxx. Les premiers résultats devraient voir le jour début 2007, avec deux solutions possibles. Soit un procès en bonne et due forme, soit un accord, où la compagnie accepte de dédommager les victimes. « Ils vont peut-être accepter de transiger » explique Georges-Alexandre Imbert, « cela leur coûtera moins cher ».
Nouvelles techniques de pharmacovigilance, procès, ces évolutions permettront-elles de lire sereinement les notices des médicaments ? A voir.
La catastrophe de la thalidomide
Un exemple frappant, celui de la thalidomide. En 1954, un laboratoire allemand élabore une nouvelle molécule médicamenteuse. Très prometteuse, elle est utilisée comme calmant. Avec un avantage non négligeable : au contraire des barbituriques utilisés à l’époque, un surdosage ne peut provoquer le décès. Fini les suicides aux somnifères. Elle est aussi préconisée contre les nausées et les vomissements des femmes enceintes. A l’époque, on considérait que le placenta était une sorte de barrière de protection. Tant que le produit n’était pas toxique pour la mère, il ne l’était pas non plus sur le fœtus. Dès sa mise sur le marché en 1957, elle rencontre le succès. A grand coup de campagnes de publicité, elle devient rapidement un best-seller. Tout d’abord en Allemagne, puis dans 46 autres pays, en Europe, Asie, Afrique, Australie... Deux ans après sa mise sur le marché, un million d’Allemands l’utilisent quotidiennement. Elle devient le troisième médicament le plus vendu en Europe.
Il était tellement sûr qu’il pouvait être acheté sans prescription ! Pourtant des effets indésirables graves sont rapidement reportés (névrites parfois irréversibles). Il faut malgré tout attendre la fin de l’été 1961 pour que, contraint, le laboratoire accepte de rendre la prescription médicale obligatoire.
En même temps, les hôpitaux allemands constatent une augmentation du nombre de nouveaux-nés présentant des malformations des membres. Cela va de l’absence d’oreilles aux anomalies cardiaques, digestives, urinaires… à la phocomélie. Dans ce cas, les mains et/ou les pieds sont directement rattachés au tronc. D’autres cas apparaissent un peu partout dans le monde, en Angleterre, au Canada, en Belgique, au Brésil…
Ces cas de phocomélie trop nombreux commencent à affoler les statistiques. Mais en l’absence de communication entre les centres ou entre les pays, le phénomène mettra des années avant d’être pris au sérieux. Pas moins de 5 ans seront nécessaires pour faire un lien entre le premier bébé atteint en 1956 et la prise de médicaments pendant la grossesse. Pourtant, en septembre 1961, le produit incriminé n’est pas encore détecté.
Deux médecins, l’un pédiatre allemand et l’autre obstétricien australien, vont finir par relier thalidomide et phocomélie quelques mois plus tard. Après leurs publications scientifiques et articles dans les journaux grand public, les laboratoires allemands et anglais, sous la pression, vont accepter de retirer le médicament du marché en décembre 1961. Le Canada attendra encore 3 mois avant de l’interdire, tout comme la Belgique, le Brésil ou l’Italie. Au Japon, le thalidomide sera disponible jusqu’en septembre 1962.
On estime entre 10 000 et 20 000 le nombre de bébés venus au monde handicapés à cause du thalidomide. Près de 3 000 ont été reconnus en Allemagne, 450 en Angleterre, 300 au Japon… Environ 5 000 sont toujours vivants aujourd’hui. Théoriquement, il ne peut exister de cas similaires en France et aux Etats-Unis, le médicament étant en attente d’officialisation en 1961. Pourtant, une dizaine de cas ont été recensés au Etats-Unis. Comment est-ce possible ? Les laboratoires ont envoyé des échantillons aux médecins avant la décision des autorités de santé, libre à eux de les tester sur leurs patients. En France, il n’existe pas de statistiques.
"On pourrait éviter 5000 à 10000 morts par an en prévenant les accidents médicamenteux"

Le professeur Patrice Queneau est membre de l’Académie de médecine, président d’honneur de l’Association Pédagogique Nationale pour l’Enseignement de la Thérapeutique (APNET).
LaNutrition.fr : Pourquoi les essais cliniques ne sont-ils pas suffisants pour déterminer tous les effets indésirables ?
Pr Queneau : L’immense majorité des essais cliniques est réalisée avec des malades bien précis, sélectionnés. Ils ne sont ni trop jeunes ni trop âgés, ont une seule maladie. Seuls 3 à 5 % des essais portent sur des personnes âgées, même s’il y a une évolution indiscutable. Alors qu’environ 30 % des médicaments sont prescris au-delà de 70 ans.
Autre problème, la durée. On sait maîtriser, analyser et apprécier le risque à court terme. Au-delà, cela n’est pas possible. On en voit l’exemple avec le traitement hormonal contre la ménopause, dont on commence seulement aujourd’hui à vraiment appréhender le bénéfice/risque. Il faut donc travailler sur le recul.
Pourquoi les autorités ne s’impliquent-elles pas plus dans la prévention des erreurs médicamenteuses, notamment par la formation des jeunes médecins ?
Il ne faut pas faire peur aux gens, c’est un sujet tabou. Pourtant il est évident que l’on peut éviter 5 000 à 10 000 morts par an si on s’attaque à la prévention des accidents médicamenteux. Mais l’Education Nationale refuse d’enseigner suffisamment la thérapeutique à la faculté de médecine. Si on y portait plus d’intérêt, il y aurait moins d’accidents. Pour cela, il est nécessaire d’améliorer la formation initiale et continue des professionnels.
La dernière année de deuxième cycle, qui correspondait à l’internat, devrait être consacrée à la prescription, au suivi, à la surveillance et aux notifications. Il faudrait instaurer un « permis de prescrire », qui apprendrait aux étudiants en médecine à savoir gérer la totalité des soins. Pour le malade, il est important que le professionnel de santé prescrive mais aussi qu’il le surveille tout au long de son traitement. Or je suis convaincu qu’à la sortie de leurs études, les médecins ne savent pas faire une notification d’effet indésirable.
Du côté des patients, quelles sont les solutions pour éviter les erreurs médicamenteuses ?
Elles doivent venir des médecins, des pharmaciens, des infirmières mais aussi des citoyens. On sait par exemple que les deux problèmes principaux sont l’inobservance du traitement et l’automédication. Mais il ne s’agit pas de culpabiliser le malade. On a pu mal lui expliquer le fonctionnement de son traitement, à quoi il sert, pourquoi il faut le prendre régulièrement. Il peut aussi tout simplement l’oublier ou ne pas avoir envie de le prendre. Attention aussi à l’automédication : elle est parfois encouragée pour faire des économies. Pourtant un certain nombre d’accidents mortels sont dus à ces pratiques. Chacun devrait, avant le bac, suivre une formation expliquant ce qu’est un traitement, comment utiliser un médicament à bon escient.
Comment améliorer la quantité de notification chez les professionnels ?
La grande majorité des accidents graves ne sont pas déclarés aux centres de pharmacovigilance. Leurs observations sont donc très partielles. Les professionnels ont des réticences à faire la déclaration. D’une part parce qu’en France il n’existe pas de culture de notification, contrairement aux pays scandinaves et anglo-saxons. D’autre part parce que souvent, il est difficile d’être certain que le médicament est en cause. Mais il ne faut pas conclure que puisque l’on n’est pas sûr, ce n’est pas médicamenteux. On fait là une faute grave. Il faudrait déclarer dès lors qu’il y a une probabilité, déclencher un réflexe. Se dire : « je ne suis pas sûr mais j’ai observé ça », quitte à revenir ensuite sur la notification. C’est le travail des centres de pharmacovigilance, qui doivent déterminer si le lien entre le médicament et l’effet indésirable est vraisemblable ou non.
1. Imbs JL , Pouyanne P, Haramburu F et al. : Iatrogénie médicamenteuse : estimation de sa prévalence dans les hôpitaux publics français. Thérapie 1999, 54 : 21-27
2. Haramburu F, Pouyanne P, Imbs JL, Blayac JP, Begaud B. : Incidence et prévalence des effets indésirables des médicaments. Presse Med 2000 ; 29(2) : 111-4.
3. Queneau P, Chabot JM, Rajaona H et al. : Iatrogénie observée en milieu hospitalier. A propos de 109 cas colligés à partir d’une enquête transversale de l’APNET. Bull. Acad. Méd., 1992, 176 (4) : 511-529
4. Queneau P, Bannwarth B, Carpentier F, Guliana JM, Bouget J, Trombert B, Leverve X, Association Pedagogique Nationale pour l'Enseignement de la Therapeutique : Adverse drug effects observed at French admissions departments and emergency services (Prospective study of the National Educational Association for Teaching Therapeutics and proposals for preventive measures. Bull Acad Natl Med. 2003;187(4):647-66; discussion 666-70.
5. Pouyanne P, Haramburu F, Imbs JL, Begaud B. : Admissions to hospital caused by adverse drug reactions: cross sectional incidence study. French Pharmacovigilance Centres. BMJ 2000;320(7241):1036
6. Einarson TR. Drug retated hospital admissions. Ann Pharmacother 1993 ; 27 : 832-40.
7. Bégaud B. et al. : Does age increase the risk of adverse drug reaction? Br. J. Clin. Pharmacol ;2002; 54 : 548-552.
8. Doucet J. et al : Les effets indésirables des médicaments chez le sujet âgé : épidémiologie et prévention. La presse médicale ; octobre 1999 ;28 (32) : 1789-1793.
9. Ankri J. : Le risque iatrogène médicamenteux chez le sujet âgé. Gérontologie et Société ; décembre 2002 ;103 : 93-103.
10. Commission de la transparence ''Avis de la commission - Vioxx'' 30 août 2000 : 8 pages
11. Bombardier C, Laine L, Reicin A, Shapiro D, Burgos-Vargas R, Davis B, et al. (2000). Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 343 (21), 1520-8.
12. The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products "Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) opinion following an article 31 referral for all medicinal products containing celecoxib, etoricoxib, parecoxib, rofecoxib, or valdecoxib" et "Scientific conclusions".
13. Graham D.J. : Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with COX-2 selective and non-selective NSAIDs. Scott V.; S. Peck et P. Kendall. Prevention of falls and injuries among the elderly: A special report from the Office of the Provincial Health Officer. Victoria, C.-B. : Ministry of Health Planning, 2004


 Mais les professionnels de santé ne sont pas les seuls fautifs ! Les malades ont aussi leur part de responsabilité. Elle a même été chiffrée en 2003, dans une étude prospective de l’APNET sur 1937 patients hospitalisés. Résultat, la moitié des effets indésirables évitables sont provoqués par le patient. En cause, une mauvaise observance des traitements, un arrêt trop brutal ou une mauvaise automédication. Côté soignants, la faute incomberait à de mauvaises prescriptions ou un manque de surveillance et de suivi à l’hôpital. Typiques des prescriptions erronées, les associations dangereuses de médicaments. Le risque de subir un effet secondaire est de 9,5 % pour un patient qui prend un seul produit. Il passe à 19,4 % avec deux à quatre médicaments puis jusqu’à 35,6 % pour dix médicaments ou plus.
Mais les professionnels de santé ne sont pas les seuls fautifs ! Les malades ont aussi leur part de responsabilité. Elle a même été chiffrée en 2003, dans une étude prospective de l’APNET sur 1937 patients hospitalisés. Résultat, la moitié des effets indésirables évitables sont provoqués par le patient. En cause, une mauvaise observance des traitements, un arrêt trop brutal ou une mauvaise automédication. Côté soignants, la faute incomberait à de mauvaises prescriptions ou un manque de surveillance et de suivi à l’hôpital. Typiques des prescriptions erronées, les associations dangereuses de médicaments. Le risque de subir un effet secondaire est de 9,5 % pour un patient qui prend un seul produit. Il passe à 19,4 % avec deux à quatre médicaments puis jusqu’à 35,6 % pour dix médicaments ou plus. Mais c’est avec ces essais cliniques que le bât blesse : ils ne peuvent durer indéfiniment. Or certains effets n’apparaissent qu’au bout de plusieurs mois ou années d’un traitement continu. Il y a donc forcément un manque de données sur le long terme. D’autre part, les patients sont véritablement sélectionnés pour les tests. Ils ont tous le même profil, ne prennent aucun autre médicament et sont très surveillés. Après cette sélection draconienne, cette population testée n’est plus très représentative de celle qui utilisera le produit. Ainsi sont généralement exclus les personnes âgées et les enfants. Claude Huriet, président de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a indiqué lors d’une audition au Sénat que « les neuf dixièmes des médicaments administrés aux enfants sont prescrits hors du champ défini par l'AMM ». En d’autres termes, les doses à administrer aux enfants n’ont pas été définies ni contrôlées avant la commercialisation du produit. Problème, un corps d’enfant ou de prématuré, dont le foie et les reins sont immatures, ne réagit pas de la même façon que celui d’un volontaire sélectionné. Même remarque avec un corps de personne âgée. Un exemple frappant, celui du diazepam (Valium®). Le diazepam est une molécule lipophyle, qui s’accumule dans les tissus gras et est évacuée beaucoup plus lentement chez le patient âgé. Selon un rapport de l’Académie nationale de Pharmacie (2005), elle va être éliminée de moitié au bout d’une journée à l’âge de 20 ans, alors qu’il faudra 3 jours chez une personne de 70 ans. La posologie indiquée suite aux essais cliniques effectués sur des patients d'âge moyen est donc inadaptée aux malades âgés et risque d’augmenter les effets indésirables (chutes, anxiété, dépression...). Or cette dernière population est justement la plus grande consommatrice de médicaments : en 2001, les plus de 65 ans consommaient 39 % des médicaments prescrits en ville (données CNAMTS). Ils sont aussi plus souvent victimes d’effets secondaires, ce que constate une étude française menée en 2002. Après 65 ans, les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents et 10 à 20 % d’entre eux conduisent à une hospitalisation.
Mais c’est avec ces essais cliniques que le bât blesse : ils ne peuvent durer indéfiniment. Or certains effets n’apparaissent qu’au bout de plusieurs mois ou années d’un traitement continu. Il y a donc forcément un manque de données sur le long terme. D’autre part, les patients sont véritablement sélectionnés pour les tests. Ils ont tous le même profil, ne prennent aucun autre médicament et sont très surveillés. Après cette sélection draconienne, cette population testée n’est plus très représentative de celle qui utilisera le produit. Ainsi sont généralement exclus les personnes âgées et les enfants. Claude Huriet, président de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) a indiqué lors d’une audition au Sénat que « les neuf dixièmes des médicaments administrés aux enfants sont prescrits hors du champ défini par l'AMM ». En d’autres termes, les doses à administrer aux enfants n’ont pas été définies ni contrôlées avant la commercialisation du produit. Problème, un corps d’enfant ou de prématuré, dont le foie et les reins sont immatures, ne réagit pas de la même façon que celui d’un volontaire sélectionné. Même remarque avec un corps de personne âgée. Un exemple frappant, celui du diazepam (Valium®). Le diazepam est une molécule lipophyle, qui s’accumule dans les tissus gras et est évacuée beaucoup plus lentement chez le patient âgé. Selon un rapport de l’Académie nationale de Pharmacie (2005), elle va être éliminée de moitié au bout d’une journée à l’âge de 20 ans, alors qu’il faudra 3 jours chez une personne de 70 ans. La posologie indiquée suite aux essais cliniques effectués sur des patients d'âge moyen est donc inadaptée aux malades âgés et risque d’augmenter les effets indésirables (chutes, anxiété, dépression...). Or cette dernière population est justement la plus grande consommatrice de médicaments : en 2001, les plus de 65 ans consommaient 39 % des médicaments prescrits en ville (données CNAMTS). Ils sont aussi plus souvent victimes d’effets secondaires, ce que constate une étude française menée en 2002. Après 65 ans, les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents et 10 à 20 % d’entre eux conduisent à une hospitalisation. A posteriori, des contrôles existent donc. Ils sont mis en place dès la commercialisation du médicament. Après la délivrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché, une dernière étape se met en place. Il s’agit d’un suivi à long terme, qui n’implique plus de tests sur des personnes. Cette pharmacovigilance a notamment pour but d’étudier les effets inattendus du médicament, tout au long de sa « vie ».
A posteriori, des contrôles existent donc. Ils sont mis en place dès la commercialisation du médicament. Après la délivrance de l’Autorisation de Mise sur le Marché, une dernière étape se met en place. Il s’agit d’un suivi à long terme, qui n’implique plus de tests sur des personnes. Cette pharmacovigilance a notamment pour but d’étudier les effets inattendus du médicament, tout au long de sa « vie ». Malgré tout, ce système de signalisation reste insuffisant. Le nombre de notifications spontanées est largement inférieur aux dégâts causés par les effets indésirables. Il semblerait que les professionnels de santé soient quelques peu réticents à effectuer les démarches nécessaires. Un phénomène qui touche surtout les généralistes et les pharmaciens. Ils ne sont à l’origine que de 8 et 11 % des déclarations d’effets indésirables. Contre 79 % pour les spécialistes. Par négligence, manque de temps, par peur d’être impliqué dans un litige, de paraître incompétent, d’être jugé responsable de la maladie d’un patient... Les raisons ne manquent pas.
Malgré tout, ce système de signalisation reste insuffisant. Le nombre de notifications spontanées est largement inférieur aux dégâts causés par les effets indésirables. Il semblerait que les professionnels de santé soient quelques peu réticents à effectuer les démarches nécessaires. Un phénomène qui touche surtout les généralistes et les pharmaciens. Ils ne sont à l’origine que de 8 et 11 % des déclarations d’effets indésirables. Contre 79 % pour les spécialistes. Par négligence, manque de temps, par peur d’être impliqué dans un litige, de paraître incompétent, d’être jugé responsable de la maladie d’un patient... Les raisons ne manquent pas.